| Pour Noël ou le Jour de l’An, certains d’entre vous ont peut être
reçu en cadeau une liseuse numérique. Ce petit appareil dédié,
qui permet de lire des textes sur un écran, peut contenir des centaines
de livres. Une vraie bibliothèque portative, que l’on complète
par l’achat de nouveaux ouvrages sur internet. Une révolution dans
le monde du livre, tant pour les lecteurs, que pour les éditeurs
et les auteurs. Certains d’entre eux publient d’ailleurs directement en
numérique : c’est moins cher, plus pratique et instantané.
Fini le compte d’auteur, tout un chacun peut répandre sa prose sur
la toile ; terminés aussi les invendus et le pilon… N’en déplaise
toutefois aux économistes, aux prophètes et aux geeks, le
bouleversement attendu (ou redouté) par l’introduction de ces nouvelles
technologies n’est pas au rendez-vous. Pas encore. Pour les livres, la
version « papier » reste la préférence des lecteurs,
même si l’époque de Gutenberg semble bien loin de nous… et
même si le texte que vous êtes en train de lire s’affiche sur
un écran plutôt que sur du papier ! Justement, en parlant
de Gutenberg… Pourquoi ne ferions-nous pas fonctionner, une fois de plus,
la machine à remonter le temps ? Elle n’est pas (encore) numérique,
cette machine-là… Profitons-en, vite ! |
Il était une fois l’imprimerie…

Gutenberg
(Source : Wikipédia)
|
Le héros de l’histoire, s’appelle Johannes Gensfleisch.
La postérité s’en souviendra mieux sous le patronyme de Gutenberg
et comme inventeur de l’imprimerie. "Inventeur" n’est pas tout à
fait le terme exact. L’imprimerie existait avant lui et depuis longtemps.
Si les Egyptiens écrivaient, à la main, sur papyrus, et si
les moines du Moyen-Age recopiaient, toujours à la main, les textes
bibliques, il existait toutefois un embryon d’imprimerie : dans ces ouvrages,
certaines lettrines étaient reproduites à l’aide d’un tampon
trempé dans l’encre, pour aller plus vite. |
| Au 7ème siècle, en Chine, on gravait
les textes sur une planche de bois puis on les reproduisait sur une feuille
de papier à l’aide de cette gravure imprégnée d’encre.
Cette technique (dite "xylographie") était particulièrement
contraignante : l’oubli d’un mot sur la page, par exemple, obligeait le
scripteur à refaire toute la gravure ! Quelques siècles plus
tard, et moyennant quelques têtes coupées pour l’exemple,
les Chinois, toujours eux, adoptent les caractères mobiles en
terre cuite, qu’ils utilisent comme des tampons en les imprégnant
d’encre à l’eau, la fameuse "encre de chine". |
 |
. |
Un peu plus tard, certains maladroits ayant payé
de leur tête le bris des caractères en terre cuite, les caractères
mobiles seront fabriqués en bois puis en métal, plus résistants.
Parallèlement, les supports de l’écriture évoluent.
Le papyrus en rouleau ("volumen", en latin "chose enroulée")
cède la place aux pages reliées entre elles ("codex",
en latin "blocs de bois", les pages étant à l’origine
des planchettes de bois gravées). Ce changement est primordial.
Jusqu’alors, le maniement du rouleau de papyrus occupait les 2 mains du
lecteur et ne facilitait pas la prise de notes. On ne pouvait même
pas se gratter le nez, signe tangible et universel de la réflexion,
sans que le manuscrit ne se réenroulasse traitreusement. |
| Autre inconvénient d’un tel support : on devait lire le texte
en suivant l’ordre de déroulement du parchemin, c’est-à-dire
séquentiellement. Difficile, sinon impossible, d’accéder
directement à un endroit précis de l’ouvrage. Toutes choses
qui vont être transformées par l’usage du codex, que l’on
peut feuilleter d’une main tout en se curant le nez de l’autre, où
l’on peut, sans attendre la fin, connaître le nom de l’assassin.
Le codex est un peu comme une machine organisée à accès
direct. D’ailleurs il a donné son nom et prêté ses
qualités à tous ces ouvrages qui permettent de classer par
chapitre, article, alinéa : les "codes" (code civil, code
du travail, code de la route…) |
Autre progrès pour les supports d’écriture
: après avoir abandonné le papyrus au profit du parchemin,
on substitue à ce dernier le papier, plus facile et plus rapide
à fabriquer et surtout beaucoup moins coûteux.
Tous ces éléments vont favoriser la naissance de l’imprimerie.
Gutenberg, s’il n’invente rien de spécialement nouveau ou génial,
est le catalyseur de ces différents progrès, en en perfectionnant
les procédés : |
 |
- Il met au point la fonderie des caractères en métal,
en créant le "plomb typographique", un alliage de plomb,
d’étain et d’antimoine (ce qui ne vise pas directement les moines
copistes, bien que…)
- Il perfectionne la presse à imprimer, en s’inspirant
de celle des vignerons. Les chinois frottaient simplement le papier sur
la gravure à l’aide de cales en bois recouvertes de tissu.
- Enfin, il invente une encre typographique, épaisse et
grasse, mieux adaptée aux nouveaux caractères en métal.
Ces 3 progrès techniques vont perdurer et ne connaître
aucune autre évolution du 15ème siècle jusqu’au début
du 20ème !
|
Gutenberg fait ses premières armes en imprimant,
en 1451, une petite grammaire latine, qui passe inaperçue. Son coup
de maître sera, en 1455, l’impression de la Bible dite "de Gutenberg",
appelée aussi "B42", car comportant 2 colonnes de 42 lignes
à chaque page.
Afin de ne pas perturber le lecteur en changeant trop ses habitudes,
cette Bible utilise une police typographique spécialement fondue
à cette occasion et calquée sur celle employée par
les moines dans leurs travaux manuscrits : la textura gothique (voir
fac-similé ci-contre).
Elle comporte également, comme dans les prestigieux livres décorés
de l’époque, des lettrines en couleur, imprimées manuellement
à l’aide de tampons de bois. Enfin, certains acquéreurs font
décorer leur exemplaire d’enluminures.
L’ouvrage, en 2 volumes, comporte 1282 pages au total. Il en sera tiré
180 exemplaires et cette opération occupera Gutenberg et son équipe
pendant 3 ans, soit le temps nécessaire à un moine pour copier
manuellement la Bible, mais en un seul exemplaire ! C’est là tout
l’intérêt du procédé. |
 Première page de la fameuse Bible
Gutenberg
Première page de la fameuse Bible
Gutenberg
(Source : Wikipedia)
|
| De nos jours, il reste dans le monde 48 exemplaires de ce premier livre
imprimé, dont le prix unitaire avoisine les… 10 millions de dollars.
Cette bible et les publications qui suivront, entre 1450 et 1501, sont
dites "incunables" (en latin, "langes du nouveau né"),
signifiant par là qu’ils constituent le berceau de l’imprimerie.
C’est effectivement un nouveau né qui promet. |
« Ceci tuera cela »
 |
On a peine à imaginer la révolution culturelle,
humaine et économique provoquée par cette invention. En multipliant
les exemplaires à partir de la source première et unique
du manuscrit, l’imprimerie va non seulement assurer la pérennité
et la diffusion de l’œuvre à travers le temps et l’espace, mais
donner à chacun la possibilité de connaître, par lui-même
le texte original. Lire dans le texte, était alors réservé
à une élite, assez fortunée pour se procurer une copie
manuelle auprès des moines copistes. |
| Avant le développement de l’imprimerie, les étudiants
devaient se rendre dans les bibliothèques et y copier les ouvrages
qui les intéressaient. Pour les autres, qui ne savaient pas ou peu
lire, ils devaient s’en remettre à la parole du prêche et
aux sculptures des églises. L’imprimerie va permettre le développement
et le partage de la connaissance, l’éclosion de la pensée
personnelle, l’émergence de la pensée individuelle et de
l’esprit critique. Un bouleversement.
Dans son roman "Notre Dame de Paris", Victor Hugo résume ce passage
des ténèbres à la lumière, du Moyen-Age à
la Renaissance, en une phrase : "Ceci tuera cela". Le livre détrônera
les cathédrales. Le chapitre remplacera le chapiteau. Si, au début,
le livre ne s’adresse bien évidemment qu’à ceux qui savent
lire, la profusion des imprimés, dans les années qui suivent,
va développer la soif d’apprendre. De 80% d’illettrés au
16ème siècle, on passe à 7% de nos jours (ce qui reste
encore trop). Du VIème siècle, époque où n’existent
que les manuscrits, au XVIIIème siècle, où le livre
imprimé est définitivement établi, le nombre d’ouvrages
en circulation a été multiplié par… 70.000 ! |
Un nouveau monde
| Par les nouveaux savoir-faire qu’elle nécessite,
l’imprimerie crée de nouveaux métiers.
Au 16e siècle il n’est pas rare qu’un artisan assure seul
l’ensemble des tâches qu’une telle activité suppose. Un imprimeur
comme Gutenberg fonde lui-même ses caractères (métier
de fondeur), compose les textes avec les caractères de plomb
(métier
de typographe), imprime les feuilles (métier de pressier),
relis et corrige les épreuves (métier de correcteur),
fabrique le livre en cousant les pages entre elles
(façonnier)
et enfin vend, il faut l’espérer, les exemplaires achevés
à sa clientèle (éditeur-libraire) ! Certains
iront même jusqu’à écrire les propres livres qu’ils
impriment !
Que de métiers pour un seul homme, mais cela correspond bien
à l’image que l’on se fait de l’homme de la Renaissance, ouvert
et curieux de tout, protéiforme. Dans la pratique, les différentes
étapes nécessaires au travail d’impression sont confiées
à une équipe afin d’accélérer et faciliter
la tâche. |
 |
Ce fac-similé de gravure ancienne représente
un
atelier d’imprimerie au 16ème siècle :
= A gauche on reconnaît le typographe en train de
composer le texte.
= Complètement à droite, le pressier (qui s’occupe
de la presse à imprimer) encre les caractères.
= Enfin, au milieu, le correcteur (sans doute le patron) vérifie
le tirage d’une feuille.
(Source : Wikipédia)
|
Plus tard, puis avec l’industrialisation, les entreprises
finiront par se spécialiser : fonderie de caractères, atelier
de composition, imprimerie, un même travail voyageant alors d’atelier
en atelier, parfois de pays en pays (imprimé en France, broché
en Belgique, par exemple).
Pour en finir avec Gutenberg, si j’ose dire, le succès de sa
Bible ne lui porta pas chance. Pour mener à bien son projet, Gutenberg
s’était endetté auprès d’un associé. Ce dernier,
peu scrupuleux, fait saisir tout le matériel d’imprimerie à
son profit et abandonne à son triste sort notre pauvre Gutenberg
qui finit ses jours sans un sou et oublié de tous. Il meurt en 1468,
un peu plus de 20 ans avant la découverte de l’Amérique. |
L’homme de l’art : le typographe
| Les techniques que nous allons décrire ont été
utilisées du 16ème jusqu’à la fin du 19ème
siècle. Ce n’est qu’avec la mécanisation de l’impression,
dans les années 1900 et plus tard avec l’apparition de l’informatique,
que ces procédés furent abandonnés, tout en conservant
le vocabulaire qui y était attaché.
La typographie (grec "typos", empreinte, et "graphia",
écrire)
est l’ensemble des procédés de composition et d’impression
utilisant des caractères et des formes en relief. C’est aussi l’ensemble
des règles esthétiques et pratiques permettant de mettre
en page les imprimés (règles qui sont appliquées de
nos jours par les programmes de traitement de texte et les machines informatiques
d’impression). Par extension, on parle également de typographie
s’agissant du dessin des caractères, de la création des polices
et du lettrage. Toutefois, à l’origine, la typographie est fondamentalement
l’art d’assembler les caractères afin de former des mots, des phrases
et de les imprimer.
La typographie, dite aussi "typo", abréviation qui s’applique
également au typographe, a été pendant longtemps la
seule méthode d’imprimerie. Elle concerne les caractères
mobiles (pour imprimer le texte) mais également toute forme en relief
destinée à l’impression, en particulier les images : gravure
sur bois, puis cliché métal, puis plaque offset…
Le typographe est donc chargé de "composer" le texte à
imprimer, c’est-à-dire de disposer les caractères mobiles
de façon à ce qu’ils reproduisent les mots et les phrases
"composant" ce texte. Pour cela, il utilise un ou plusieurs casiers en
bois, dits "casses" dans lesquels sont stockés les caractères
"en plomb" mais en fait constitués, comme on l’a vu plus haut, d’un
alliage : le plomb typographique. De la main droite, le typographe pioche
dans la casse le caractère désiré et le place dans
le "composteur" qu’il tient de sa main gauche. Le composteur est
une petite règle de métal coudée dans laquelle on
aligne les caractères, les uns après les autres, pour former
les mots. Quand une ligne est terminée, le typographe la transfère
du composteur à la "galée", plateau de zinc qui va
recevoir l’ensemble du texte. |
Les outils du typographe…
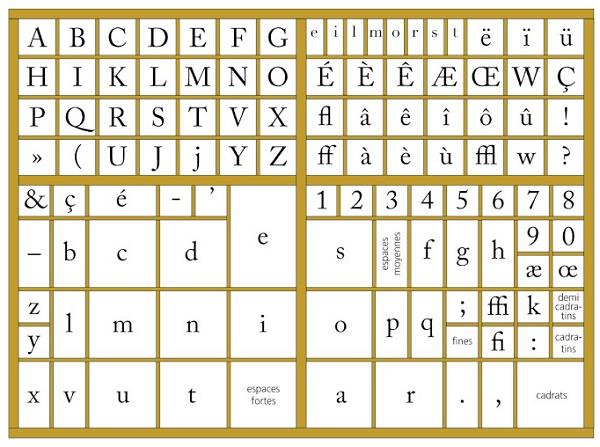
Disposition des caractères dans une casse
typographique
(Source : Wikipédia)
|

Le composteur : indispensable pour composer
la ligne de texte.
|

En haut, la pince "typo" pour saisir les
petits caractères ou réarranger les espaces.
En bas, le typomètre, règle
graduée en mm et points typographiques (cicero) qui permet
de calculer la longueur des lignes, entre autres usages.
|
Sens dessus-dessous
| Un détail, mais qui a son importance. Pour imprimer
les textes tels qu’on peut les lire couramment, les caractères en
relief sont moulés à l’envers… Dans le composteur, ils sont
donc à l’envers et la tête en bas, mais toujours placés
de gauche à droite, comme dans la lecture normale.
Sur la galée, la première ligne du texte est tout en bas
et la dernière, tout en haut. S’il ne veut pas passer sa vie à
faire le poirier ou à travailler devant un miroir, le typographe
doit donc savoir lire… à l’envers.
|

Ici, on imprimera le mot "Bas"
|

La galée, avec le texte composé.
On a rajouté un cliché (ici un plan),
mais ces éléments ne sont placés qu’à la toute
fin, sur la forme prête à passer à la presse. |
Pour séparer les mots entre eux, on place "une"
espace (féminin, dans ce cas) plus ou moins fine de façon
à ce que le texte soit "justifié" : toutes les lignes
ont alors la même longueur.
Quand la composition du texte est terminée, on attache solidement
les lignes entre elles à l’aide de plusieurs tours de ficelle, puis
l’ensemble est transféré sur la "forme", un plateau
qui reçoit le texte ainsi que les gravures ("clichés") illustrant
éventuellement le texte. C’est cette forme qui, placée sur
la presse et encrée, imprimera la page. |

Le paquet de lignes entouré de sa ficelle.
A serrer très fort si on veut éviter
que ça "tombe en pâte", les caractères
se désolidarisant les uns des autres (maladresse souvent commise
par les apprentis).
|
| Ces exigences professionnelles expliquent le statut particulier
du typographe durant le Moyen-Age et plus tard. Il faisait partie des ouvriers
sachant, de par les obligations du métier, lire et écrire,
ce qui n’était pas, loin s’en faut, le cas pour tout le monde. A
la Renaissance, le travail d’imprimeur est considéré comme
prestigieux. Les typographes portent l’épée, parlent latin
et grec et fréquentent les lettrés de l’époque. Plus
près de nous, le monde de l’imprimerie fut souvent propagateur des
idées nouvelles et à la pointe des mouvements sociaux. |
Secrets professionnels
Comme tout métier, celui de typographe a ses coutumes,
son argot, ses maladies.
Les "ouvriers du livre" fêtent leur saint patron, Saint-Jean
Porte Latine, le 6 mai. A cette occasion, et en bien d’autres, ils boivent
un coup et entonnent alors en chœur le fameux "A la…" :
"A la santé du compère qui nous régale
aujourd’hui..."
Cet air à boire a depuis été repris par de nombreuses
confréries et joyeuses assemblées, mais son origine est "typographique". |

|
| Plus dramatique est la maladie du typographe : manipulant
du plomb à longueur de journée, d’année, il s’expose
au saturnisme, une maladie très grave à l’issue souvent
fatale. Heureusement, les règles d’hygiène et la disparition
progressive du plomb ont éradiqué la maladie, du moins dans
ce milieu professionnel.
Plus gai, l’argot ! L’argot de l’imprimerie est très riche
et à l’origine de nombre d’expressions passées dans le langage
courant. Quelques unes à titre d’illustration… |
| "Enfant de la balle" : désigne
l’ouvrier typographe dont le père est lui-même typographe.
La "balle" était ce tampon de cuir, d’étoffe et de crin de
cheval qui servait à encrer la forme, avant l’invention du rouleau
encreur en caoutchouc.
"Etre à la bourre" : être en
retard. Le typographe qui était en retard, "bourrait les lignes"
pour terminer plus vite.
"Ours" : c’est l’imprimeur, le pressier,
celui qui manipule la presse à imprimer. "Visser un ours"
c’est arrêter la machine pour bavarder (ou boire un coup). |

Balle à encrer
(Source : Gallimard)
|
| "Singe" : désigne l’ouvrier
typographe, du fait de ses gestes saccadés et rapides lorsqu’il
compose ses textes.
"Prote" : c’est le chef d’atelier, du grec
"protos" (premier).
"Coquille" : omission, interversion ou substitution
d’un ou plusieurs caractères. Pour éviter ce genre de désagrément,
bête noire du typographe, celui-ci est tenu de "tirer une épreuve"
de ce qu’il a composé et de la relire… Les exigences de la productivité
font que parfois la coquille passe à travers les mailles du filet. |

|
On dit que Malherbe composant le poème "Consolation
à M. Du Perrier", aurait écrit :
Et Rosette a vécu ce que
vivent les roses…
Un typographe distrait, confondant les 2 "T" avec 2 "L",
aurait alors composé :
Et Rose, elle a vécu ce
que vivent les roses…
C’est la version erronée, plus originale, qui est passée
à la postérité. Comme quoi le typographe est aussi
poète… D’après les experts, tout ceci ne serait qu’une légende.
Qu’importe ! On peut rêver… |
Les Gutenberg modernes
| Le temps a passé, les techniques modernes ont apporté
leur lot de progrès et de bouleversement dans la profession du livre.
Après la mécanisation des presses, la mécanisation
de la fonderie des caractères (linotype, puis monotype fondant les
caractères à la demande), le plomb typographique finit par
disparaître au profit de la photocomposition.
Plus récemment, l’informatique a envahi la chaine de production
du livre et de la presse, reléguant au musée le matériel
du typographe et la presse de Gutenberg. |
 Machine "Monotype"
Machine "Monotype"
à l'imprimerie "L'Echo de la Mode" en
1969
(Photo de H. Robert)
|
| La plupart des livres que nous feuilletons de nos jours
sortent d’imprimantes numériques. Toutefois, il existe encore quelques
artisans utilisant les techniques traditionnelles pour des petits travaux,
prospectus, cartes de visite ou tirages prestigieux de collection. Enfin,
au hasard d’un petit tour chez les bouquinistes ou les vieux libraires,
vous tomberez sans doute sur un de ces exemplaires imprimés à
l’ancienne : si vous promenez vos doigts sur le verso des pages, vous sentirez
le " foulage" des caractères, c’est-à-dire l’empreinte en
relief laissée sur le papier par les lettres de plomb lors de leur
passage dans la presse. Et ce simple geste, cette simple sensation, vous
feront "toucher du doigt", c’est le cas de le dire, le travail des hommes
qui ont fabriqué le livre que vous avez ouvert. Et tous ceux qui
publient numériquement sur la toile le savent bien, même s’ils
ne l’avouent pas : rien ne vaut le plaisir de voir son œuvre "gravée"
sur le papier ! En quelque sorte, l’imprimeur est celui qui permet
à l’auteur de naître au monde. Tout le reste n’est que manuscrit… |
Hommage

"Les paroles s’envolent, les écrits
restent" |
Le matériel typographique, dont quelques photos illustrent
cet article, appartient à mon père. Enfant de la balle, dans
toute l’acception du terme, car ayant débuté comme "typo"
auprès de ses parents, tous deux typographes de formation également,
il fit toute sa carrière dans l’imprimerie et vécut les révolutions
technologiques successives du secteur.
Si ma mère m’a donné l’amour des belles lettres, lui me
transmit le goût des beaux caractères. Ceci rejoint cela.
Merci à tous les deux.
Et pour finir avec un jeu de mots typographique, je dirai qu’il a toujours
"bon
pied, bon œil" (1).
------------------------------------------
(1) L’œil est la hauteur des minuscules, sans les jambages.
Le pied ou ligne de pied est la ligne sur laquelle s’alignent
les caractères. |
Texte, photos et dessins
de Guy Robert, sauf indication contraire.
Le matériel typographique
est celui utilisé par mon père Henri Robert durant sa vie
d’imprimeur.
Autres sources d’images
et d’informations : "L’écriture et le livre" (Gallimard) et l'incontournable
"Wikipédia"
© Linutil, janvier 2018
|

